- coquemar
-
coquemar [ kɔkmar ] n. m.• 1280; p.-ê. du néerl. kookmoor ou du bas lat. cucuma♦ Bouilloire à anse. « un coquemar de fonte pendu à la crémaillère » (Gautier) .
● coquemar nom masculin (peut-être néerlandais kookmoor, de koken, bouillir, et moor, chaudron) Récipient de terre ou de métal utilisé autrefois pour faire bouillir l'eau.coquemarn. m. (Acadie) Bouilloire. Mettre le coquemar sur le feu.⇒COQUEMAR, subst. masc.ARTS MÉN. Bouilloire de terre ou de métal, munie d'une anse et parfois d'un couvercle, d'un bec et de (trois) pieds. Les cuisines du château (...) meublées de casseroles, poêles, poêlons, chaudrons, coquemars (A. FRANCE, Balth., Abeille, 1889, p. 170). Un coquemar de terre brune laissait fuser une fine vapeur de son couvercle (MOSELLY, Terres lorr., 1907, p. 64) :• Un maigre feu léchait de ses langues jaunes la plaque de la cheminée, et de temps en temps atteignait le fond d'un coquemar de fonte pendu à la crémaillère...T. GAUTIER, Le Capitaine Fracasse, 1863, p. 10.— P. méton. Contenu d'un coquemar. Des décoctions d'écorce de saule, dont un grand coquemar bouillonnait sur le feu (LA VARENDE, Homme aux gants, 1943, p. 95).Prononc. et Orth. :[ ]. Ds Ac. depuis 1694. Fait partie des mots dans lesquels r final est anal. ayant été ajouté par substitution de suff. à l'époque où les consonnes finales ne se prononçaient plus (XVIIe-XVIIIe s.). D'abord muet, cet r est devenu sonore p. anal. avec celui des mots dans lesquels il était étymologique. Étymol. et Hist. 1280 coquemar (Arch. du Nord, Chambre des Comptes, n° 2217 et 4347 bis, Dehaisnes ds GAY, s.v. gésine). Orig. obsc. L'étymon gr. byzantin
]. Ds Ac. depuis 1694. Fait partie des mots dans lesquels r final est anal. ayant été ajouté par substitution de suff. à l'époque où les consonnes finales ne se prononçaient plus (XVIIe-XVIIIe s.). D'abord muet, cet r est devenu sonore p. anal. avec celui des mots dans lesquels il était étymologique. Étymol. et Hist. 1280 coquemar (Arch. du Nord, Chambre des Comptes, n° 2217 et 4347 bis, Dehaisnes ds GAY, s.v. gésine). Orig. obsc. L'étymon gr. byzantin 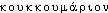 (dér. de
(dér. de  , DU CANGE grec et TLL, s.v. cucuma, lat. cucuma « marmite, chaudron »; L. Sainéan ds Z. rom. Philol., t. 30, 1906, p. 307; REW3, n° 2362; FEW t. 2, p. 1456; BL.-W.5) qui paraît seul capable d'expliquer l'a. catalan cogomar (1345 ds ALC.-MOLL) est difficilement compatible avec l'aire géogr. du fr. qui semble d'orig. pic. (1280) et wallonne (v. HAUST, Dict. fr.-liégeois, s.v. bouilloire et FEW, loc. cit.) et avec l'attest. relativement tardive du prov. (1479 ds PANSIER t. 3). L'étymon flamand kookmoor « coquemar », très rare (DE BO, Westvlaamsch Idiotion d'apr. GESCH., p. 75; Tollenaere ds Z. rom. Philol., t. 60, 1940, pp. 502-506 et EWFS2) composé de koken « bouillir » et de moor « maure » (p. allus. au pot noirci par le feu de l'âtre, cf. les termes dial. : prov. maura, meusien more « marmite, pot », FEW t. 6, 1, p. 552 a et l'altération pic. de coquemar : coquenoire ds HÉCART) convient parfaitement à l'aire géogr. du mot, mais ne peut expliquer le catalan dont il est cependant difficile de séparer le français. Fréq. abs. littér. :13. Bbg. COHEN (M.). Un N. de récipient de ménage [coquemar]. In : [Mél.
, DU CANGE grec et TLL, s.v. cucuma, lat. cucuma « marmite, chaudron »; L. Sainéan ds Z. rom. Philol., t. 30, 1906, p. 307; REW3, n° 2362; FEW t. 2, p. 1456; BL.-W.5) qui paraît seul capable d'expliquer l'a. catalan cogomar (1345 ds ALC.-MOLL) est difficilement compatible avec l'aire géogr. du fr. qui semble d'orig. pic. (1280) et wallonne (v. HAUST, Dict. fr.-liégeois, s.v. bouilloire et FEW, loc. cit.) et avec l'attest. relativement tardive du prov. (1479 ds PANSIER t. 3). L'étymon flamand kookmoor « coquemar », très rare (DE BO, Westvlaamsch Idiotion d'apr. GESCH., p. 75; Tollenaere ds Z. rom. Philol., t. 60, 1940, pp. 502-506 et EWFS2) composé de koken « bouillir » et de moor « maure » (p. allus. au pot noirci par le feu de l'âtre, cf. les termes dial. : prov. maura, meusien more « marmite, pot », FEW t. 6, 1, p. 552 a et l'altération pic. de coquemar : coquenoire ds HÉCART) convient parfaitement à l'aire géogr. du mot, mais ne peut expliquer le catalan dont il est cependant difficile de séparer le français. Fréq. abs. littér. :13. Bbg. COHEN (M.). Un N. de récipient de ménage [coquemar]. In : [Mél.  (I.)]. Bratislava, 1965, pp. 79-80. — SAIN. Sources t. 2 1972 [1925], p. 259. — SAINÉAN (L.). Notes d'étymol. rom. Z. rom. Philol. 1906, t. 30, p. 307. — SPITZER (L.). Über einige Wörter der Liebesprache. Leipzig, 1918, pp. 31-32. — TOLLENAERE (F. de). Sur l'orig. du fr. coquemar. Z. rom. Philol. 1940, t. 60, pp. 502-506.coquemar [kɔkmaʀ] n. m.ÉTYM. 1280; orig. obscure, p.-ê. du néerl. kookmoor, ou du bas lat. cucuma.❖♦ Bouilloire à anse. ⇒ Coquelle.1 Un maigre feu léchait de ses langues jaunes la plaque de la cheminée, et de temps en temps atteignait le fond d'un coquemar de fonte pendu à la crémaillère (…)Th. Gautier, le Capitaine Fracasse, t. I, p. 13.2 (…) Rose mettait au feu le coquemar qui contenait le cidre sucré.P. Mac Orlan, l'Ancre de miséricorde, p. 46.♦ Par métonymie. Contenu d'un coquemar.➪ tableau Noms de récipients.❖DÉR. Coquelle.
(I.)]. Bratislava, 1965, pp. 79-80. — SAIN. Sources t. 2 1972 [1925], p. 259. — SAINÉAN (L.). Notes d'étymol. rom. Z. rom. Philol. 1906, t. 30, p. 307. — SPITZER (L.). Über einige Wörter der Liebesprache. Leipzig, 1918, pp. 31-32. — TOLLENAERE (F. de). Sur l'orig. du fr. coquemar. Z. rom. Philol. 1940, t. 60, pp. 502-506.coquemar [kɔkmaʀ] n. m.ÉTYM. 1280; orig. obscure, p.-ê. du néerl. kookmoor, ou du bas lat. cucuma.❖♦ Bouilloire à anse. ⇒ Coquelle.1 Un maigre feu léchait de ses langues jaunes la plaque de la cheminée, et de temps en temps atteignait le fond d'un coquemar de fonte pendu à la crémaillère (…)Th. Gautier, le Capitaine Fracasse, t. I, p. 13.2 (…) Rose mettait au feu le coquemar qui contenait le cidre sucré.P. Mac Orlan, l'Ancre de miséricorde, p. 46.♦ Par métonymie. Contenu d'un coquemar.➪ tableau Noms de récipients.❖DÉR. Coquelle.
Encyclopédie Universelle. 2012.
